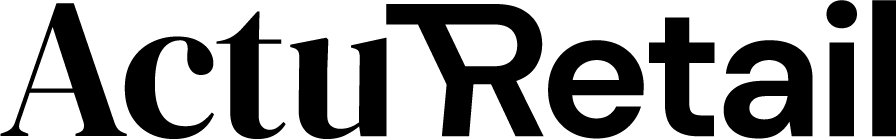Président et fondateur de Philippe Goetzmann &, société de conseil dédiée à la transformation de la grande distribution, Philippe Goetzmann est un spécialiste et un observateur averti de l’évolution des modes de consommation des Français. Il revient, pour Actu Retail, sur le bilan de l’année écoulée et dresse les perspectives pour 2021 autour de trois mots clés : télétravail, digital et pouvoir d’achat.
De nombreux analystes évoquent un monde d’après-Covid s’agissant de nos modes de consommation, en faisant de 2020 une année de rupture. Partagez-vous l’idée que nous sommes à l’aube d’une révolution en la matière ?
Philippe Goetzmann : Il y a plusieurs temporalités à distinguer. Au moment du premier confinement, j’écrivais que la crise ne changerait rien aux tendances de consommation. Je notais qu’elle ne modifierait pas les aspirations profondes des consommateurs et que les changements observés seraient de caractère conjoncturel.
J’aurais tendance à maintenir cette analyse, en la corrigeant légèrement. Je percevais les contraintes sanitaires du premier confinement comme étant limitées dans le temps. Ce facteur a changé. Dans un podcast, Emily Mayer (de l’institut d’études IRI) prenait l’exemple d’un élastique. Si vous tirez dessus et que vous le relâchez, il reprend sa forme. En revanche, si vous tirez dessus pendant longtemps, il va avoir du mal à la retrouver. La durée de ces périodes de contraintes sanitaires peut ainsi imprimer un certain nombre d’évolutions, mais pas nécessairement celles auxquelles s’attendent les tenants du « monde d’après ».
S’agissant de l’année 2020, il est difficile de distinguer en quoi les performances constatées sur certains marchés ou formats de magasin, parfois très fortes, relèvent de la conjoncture ou d’un mouvement de fond. Je vais l’illustrer avec un exemple : la tendance du fait maison. Sur l’année, la consommation de farine a explosé de même que l’ensemble des produits permettant de cuisiner un gâteau chez soi. Cela a été considérable pendant le premier confinement et la tendance, bien que plus faiblement, a perduré tout au long de l’année. Mais il faut se garder d’être péremptoire, tant il est compliqué d’apprécier s’il y a réellement une tendance de fond sur le fait maison ou non.
C’est compliqué parce que vous aviez, avant la crise sanitaire, des tendances qui existaient d’une part sur la cuisine à la maison, en tant que loisir du week-end, et d’autre part sur tout ce qui se rapporte au snacking, à la consommation « on the go » ou à la livraison – ce qui est strictement l’inverse du fait maison – lorsqu’il fallait se restaurer en semaine. Les émissions Top Chef laissaient entendre qu’il y avait de plus en plus de fait maison, alors qu’en réalité nous en avions de moins en moins en volume. Avec la crise, les confinements et la fermeture des restaurants, nous nous sommes retrouvés à devoir cuisiner du fait maison « contraint » et non plus uniquement par plaisir. La consommation, c’est souvent très trivial. Les ventes de farine traduisent cette résilience et cela continue parce qu’une part conséquente des consommateurs urbains reste en télétravail.
Plus largement, je crois que les tendances de fond de la consommation, que nous connaissions avant le Covid, sont des lignes directrices qui vont se poursuivre. Les paramètres structurels, tels que la structure des ménages ou le taux d’emploi des femmes, n’ont pas changé. Ce qui va modifier la consommation dans les temps qui viennent, c’est l’évolution marquée des contraintes. C’est-à-dire le pouvoir d’achat, la confiance des ménages, le couvre-feu ou bien encore le télétravail. Ce dernier point est un déterminant qui s’impose à nous et change la nature des lieux de consommation, en remaniant les implantations géographiques au profit des villes moyennes et des périphéries.
Les aspirations profondes exprimées par les consommateurs français, telles que celles portant sur les produits bio ou locaux, vont-elles résister aux contraintes de prix et de pouvoir d’achat que vous évoquez ?
Philippe Goetzmann : Ce sont deux tendances qui ne sont pas neuves. Il y a deux choses différentes. Je relève d’abord que le différentiel de croissance entre le bio et le conventionnel n’aura probablement jamais été aussi faible en France sur les dix dernières années. Pourtant, le bio a bénéficié mécaniquement du premier confinement du fait d’une rupture rapide sur le conventionnel, de capacités linéaires plus grandes et d’une forte densité du réseau de magasins spécialisés. Malgré cela, le bio fait probablement – tout en connaissant une croissance plus élevée que le marché – sa moins bonne année depuis dix ans. C’est un signe de décalage pour moi, car si l’on faisait une analyse de tout ce qui a été publié dans la presse ou sur les réseaux sociaux, nous dirions sans doute qu’il s’agit d’une année exceptionnelle pour le bio.
En revanche, le local a des orientations complètement différentes. Il était déjà fort et s’est consolidé. Ce qui est compliqué avec le local, c’est que nous n’avons pas de chiffres. Contrairement au bio qui est un critère précis, le produit local n’est pas défini. Le local a beaucoup progressé cette année, mais il faut distinguer la demande de l’offre. La demande de local est réelle depuis longtemps, avec une vraie prise de conscience de la part des consommateurs sur les bienfaits des produits de chez eux.
Il s’agit d’abord d’une question de confiance et pas du tout de chauvinisme. Quand vous achetez un produit local, vous avez le sentiment que le produit contribue à l’économie de proximité et, surtout, vous avez la réponse à un besoin d’incarnation : l’entreprise existe, elle se situe dans la région, vous connaissez des gens qui y travaillent, etc. Quand vous achetez un biscuit d’une marque régionale, vous accédez au produit mais aussi à son histoire, son ancrage et ses valeurs. Le biscuit d’une grande marque internationale n’aura pas cette incarnation. En ce sens, le produit local est rassurant dans une période où l’anxiété progresse.
La demande de local ne pouvait qu’être augmentée par la crise du Covid. Pour savoir si cela va se poursuivre, la clé se situe au niveau de l’offre. Les distributeurs vont-ils jouer ce jeu-là ? Manifestement, ils ont tous décidé de s’y mettre. C’est donc une tendance qui à mon sens va perdurer. Les produits locaux sont à la fois un facteur de différenciation et de libération du poids des marques nationales dans l’assortiment.
Concernant la question de l’accessibilité, le bio est une consommation très majoritairement urbaine, CSP+ et retraitée, même si cela irrigue petit à petit l’ensemble de la population. La consommation de produits locaux est quant à elle plus diffuse dans le territoire, moins parisienne. Au niveau du prix, le bio est manifestement beaucoup plus cher que le conventionnel, pour un bénéfice qui n’est pas démontré. Le bio a-t-il un bénéfice sur la santé ? Rien ne le prouve. Et il y a de plus en plus de débats autour de la qualité du label français ou européen, au point que les militants du bio plaident pour un label plus exigeant.
Pour le local, nul besoin d’un label : c’est quelque chose de tangible et le consommateur perçoit vraiment le bénéfice associé. Le surprix éventuel que cela coûte représente un arbitrage auquel l’on peut consentir. Il y aussi un besoin de revivifier les territoires. Nous sommes dans la crise du Covid, mais il ne faut pas oublier que nous étions confrontés il y a deux ans au phénomène des gilets jaunes et de désertification du territoire français au profit des métropoles, notamment Paris.
Les grandes et moyennes surfaces, notamment celles situées en périphérie, ont démontré leur utilité logistique durant la crise tandis que peut se poser la question de leur déclin. Pensez-vous que la crise réactive ces modèles supers et hypers de bordure d’agglomération ou au contraire précipitera leur disparition, au profit des enseignes de proximité ?
Philippe Goetzmann : La consommation est davantage liée aux contraintes qu’aux désirs. Les deux premiers facteurs de choix d’un magasin sont le prix et le temps. Les écarts de prix, dans les années 2000, se sont considérablement réduits entre les enseignes par le biais de la loi Galland et de ses avatars. La guerre des prix les a de nouveau creusés, bien que la loi EGalim ait tenté de rééquilibrer l’ensemble. Vous avez également le temps, qui est lié à la distance parcourue. Plus vous avez d’offres sur le territoire et plus vous avez la possibilité d’aller au plus près. Le développement massif et continu des supermarchés, après celui des hypers, fait que la contrainte de temps s’est réduite au détriment des formats les plus éloignés.
On a beaucoup parlé, cette année, de proximité. Entre 2012 et 2017, nous avons eu une forte croissance des circuits de proximité en France. Elle s’est plutôt tassée sur les années 2018 et 2019. Sur l’ensemble de la période, les réseaux de magasins de proximité se sont considérablement modernisés : prenez un Franprix en 2016, c’est un magasin bien pensé, bien construit, avec une vraie proposition marketing adaptée à sa zone de chalandise, contrairement aux points de vente de 2010. Il y a eu un vrai travail du côté de l’offre et les clients ont répondu présents. Les Intermarchés ont également connu une croissance remarquable ces dernières années, fondée sur une forte rénovation du parc de magasins.
En 2020, la proximité ne pouvait que bénéficier du confinement puisque nous y étions contraints. À partir du moment où vous devez faire vos courses dans une zone extrêmement restreinte, vous avez une prime au magasin le plus proche de chez vous. Mécaniquement, la proximité en a bénéficié beaucoup plus. La distribution du chiffre d’affaires se faisait quasiment, auparavant, au prorata des surfaces : dans ce cas, elle s’est faite au prorata des points de vente.
Malgré cela, je pense que cela ne remet absolument pas en cause les fondamentaux. Il faut regarder les chiffres. Si vous prenez le premier confinement, le chiffre d’affaires des magasins de proximité parisiens des premier, sixième, huitième et neuvième arrondissements était en recul, alors que la croissance de l’alimentaire était extrêmement élevée. C’est un symbole intéressant. Ce sont des arrondissements de bureaux et les gens se sont mis à télétravailler. Les courses du midi ou à la sortie du bureau ont disparu à cette occasion.
Le phénomène du télétravail va avoir un impact bénéfique pour la périphérie plutôt que pour la centralité. Franprix a très bien pris conscience que ses relais de croissance se situent dans les supermarchés de périphérie parisienne, avec parking, et non dans les magasins de proximité en pied d’immeuble de la capitale. C’est un élément qui va être structurant et qui peut aussi bénéficier aux hypermarchés. En périphérie, l’hypermarché reste un lieu extrêmement efficace.
J’ai d’ailleurs été étonné que, pendant le premier confinement, les hypers ne s’en soient pas mieux sortis puisqu’ils avaient l’avantage de proposer tous types de produits sur un seul moment de courses : ils éliminaient de fait un certain nombre de risques, par rapport aux mesures barrières et à la distanciation sociale. Je crois que c’est plutôt un problème d’exécution et de qualité d’offre, ce qui ouvre des pistes de progrès. Les mouvements sociologiques de fond, liés au télétravail, redonnent une vraie carte à jouer aux supers et hypers de périphérie.
La crise sanitaire a accéléré la digitalisation des courses et l’essor de la consommation omnicanale, entre drive, drive piéton et livraison à domicile. Quelles perspectives dressez-vous pour le e-commerce en 2021 ?
Philippe Goetzmann : Les trois éléments fondamentaux de l’année, pour moi, sont le télétravail, le digital et le pouvoir d’achat. Évidemment, le digital est un point majeur. Ce qui est frappant, c’est que le digital alimentaire a concerné 2,7 millions de nouveaux foyers en 2020. C’est-à-dire un taux de pénétration de 10 % de plus sur un total de 27 millions de ménages. C’est colossal. Cette progression change la nature même du commerce digital à deux titres. D’abord parce que ceux qui sont rentrés dans le commerce digital, essentiellement via le drive, sont des profils nouveaux tels que les seniors. Or, le drive était un circuit particulièrement adapté, en termes d’offre, à une consommation de ménages avec enfants. L’irruption, pour des raisons de sécurité, dans le circuit drive de clients seniors implique de repenser une offre de façon plus complexe.
Surtout, ces nouveaux consommateurs du drive étaient déjà clients des grandes enseignes. Or, les bases clients de ces dernières étaient mal construites avec un faible taux de qualification, de l’ordre de 30 %. Quand vous passez par le drive, vous renseignez votre mail ou votre numéro de téléphone, souvent les deux, et devenez automatiquement un client qualifié. Le pourcentage de clients qualifiés dans les bases des distributeurs a ainsi explosé.
Cela change tout pour le commerce digital. Tous les outils dont disposaient les distributeurs étaient jusqu’alors peu exploités, car coûteux pour des résultats limités. Désormais, ces outils vont pouvoir trouver une efficacité considérable. Je pense que 2020 signe une rupture de ce point de vue-là, avec un basculement fort des outils de marketing du monde physique vers le digital. Il est assez probable que nous connaissions une évolution importante avec des leviers marketing du retail beaucoup plus personnalisés, ciblés et fins. Cela va également amener in fine une reconfiguration de la « promo » en magasin et des relations avec les fournisseurs. La façon de concevoir une promotion via le digital n’a strictement rien à voir avec ce que nous faisions avec un tract « 25 jours Auchan » ou « Mois Carrefour ».
Nous avons mis le doigt dans l’engrenage du digital avec le drive, la livraison à domicile, etc. C’est vrai que nous avons gagné cinq ans de digitalisation en l’espace de deux mois. Il y a un an, commander pour se faire livrer un McDo relevait souvent de la transgression. Aujourd’hui, c’est complètement admis. Des barrières culturelles sont tombées.
Un dernier aspect : je suis convaincu que l’explosion digitale de l’année dernière a participé fortement à l’évolution des prix. Nous avons constaté un retour de la déflation, comme nous l’avions connu en non-alimentaire avec l’essor d’Amazon et autres. À partir du moment où vous avez des franges entières de clients en mesure de comparer les prix du Carrefour et du Leclerc depuis leur canapé, cela génère une pression concurrentielle. L’alimentaire, par le biais de la digitalisation, se retrouve sous une pression de comparabilité des prix plus forte qu’elle ne l’était l’année dernière. Et l’amplification du digital va durer par un effet générationnel.
Se constate enfin l’émergence de magasins autonomes, ouverts 24h/24 et 7j/7. S’agit-il d’un phénomène conjoncturel ou d’une tendance durable ?
Philippe Goetzmann : Le commerce s’adapte aux contraintes. Les magasins « box » autonomes vont se développer, bien sûr. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit le levier numéro un. Ces dispositifs ne sont pas gratuits, ils nécessitent de l’investissement et d’être remplis : ils sont autonomes pour le client mais pas pour les distributeurs. Ce modèle-là est-il plus efficace que le drive piéton ? Cela mérite d’être discuté. Je pense que c’est un modèle qui aura son développement, sans doute dans des zones assez particulières. Il peut s’agir de zones de flux importants. Finalement, ces magasins autonomes sont d’énormes « vending machines » : vous pourriez en avoir en pleine gare RER du Forum des Halles. Je les imagine assez bien également dans les entreprises, par exemple.
Derrière la question, il y a le sujet de l’utilité des magasins et des horaires. Le magasin autonome est un magasin de dépannage. C’est l’avantage de trouver, à minuit, un produit que vous auriez oublié dans la journée. En ce sens, il y a une utilité. En revanche, le rôle d’un magasin, qui est d’apporter des relations sociales, du conseil, une offre et un style de marque, ne pourra pas se retrouver dans ces espaces autonomes, par nature inscrits dans une logique d’efficacité. Je crois plutôt, pour l’avenir, à une multiplication du nombre de marques d’enseignes dont les missions seraient à chaque fois plus différenciées. Qu’il y ait une enseigne de dépannage, cela aurait du sens.
Le sujet questionne aussi la perception des contraintes. Le commerce en France était extraordinairement contraint, notamment en termes d’horaires et de jours d’ouverture. La crise, pour le coup, est en train de casser cela. Le fait que les magasins soient ouverts à 7h30 peut générer des habitudes de fonctionnement interne ainsi que pour les clients. De même s’agissant des dimanches. Vous avez ce type de tabous, et je le souhaite, qui sont en train de tomber. Je pense notamment aux magasins dans les villes : à Paris, les Monoprix et les Franprix étaient contraints de passer en mode autonome pour ouvrir tard ou le dimanche. Peut-être que le public, les équipes des magasins et les politiques vont aborder ces sujets-là de façon plus ouverte qu’ils ne le faisaient.