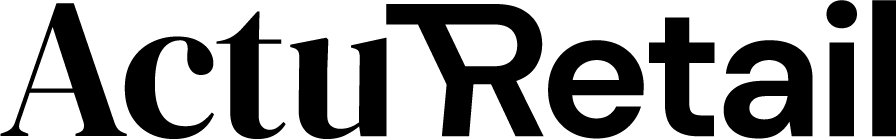Impossible de rater, entre deux métros parisiens, les publicités des entreprises dites du quick commerce. Gorillas, Cajoo, Kol, Frichti et bien d’autres, autant d’opérateurs en croissance qui fondent leur essor sur une promesse : livrer leurs consommateurs en moins de vingt minutes. Quels sont ressorts de ce phénomène ? Où s’arrêtera-t-il ? Actu Retail s’est mis en quête d’explorer les lignes de force de ce marché naissant, en interrogeant Clément Genelot, analyste financier « retail & e-commerce » chez Bryan, Garnier & Co.
Qu’appelle-t-on quick commerce et d’où vient le phénomène ?
Clément Genelot : La définition exacte n’est pas consensuelle. Les puristes diront que le quick commerce correspond aux courses livrées en moins de quinze ou vingt minutes, via un dark store. Et les groupes plus anciens, tels que Deliveroo et Uber Eats, ainsi que les food retailers estimeront qu’il s’agit de la livraison en moins d’une heure, via des magasins « classiques ». À mon sens, le vrai quick commerce, celui qui a le plus de potentiel, est celui suggéré par la première approche. Globalement, je ne suis pas fan des partenariats entre les plateformes de livraison et les magasins, que je trouve imparfaits. C’est plus une étape avant de basculer réellement vers les dark stores.
En tout cas, le dark store tel qu’on le connaît actuellement n’est pas nouveau. Il a été inventé par Getir en Turquie en 2015. Puis il a été repris par Glovo en Europe, par Frichti, par Kol, etc. Mais c’est resté assez anecdotique, en raison d’une pénétration extrêmement faible du online dans l’alimentaire. En fin de compte, le business a eu du mal à décoller. Et évidemment, la Covid autant que les confinements ont agi comme un vrai boost, les consommateurs ayant été contraints de s’ouvrir au online. L’effet Covid crée de l’intérêt et fait découvrir ce genre de services.
Quel est pour vous le potentiel véritable du marché ? Peut-on s’attendre à des success stories similaires à celles rencontrées avec le drive ou les plats en kit ?
Clément Genelot : Le quick commerce est un métier qui vise les courses en milieu urbain. Si l’on regarde le périmètre de ce segment, l’on retrouve à la fois des magasins de proximité et des supermarchés de ville. Le quick commerce pourrait digitaliser 5 à 10 % de ces ventes. Cela varie bien sûr selon les marchés. Je prends l’exemple de l’Angleterre où l’on pourra atteindre les 10 %, car la pénétration du online est déjà globalement élevée. Inversement, l’Espagne et l’Italie sont des pays plus réfractaires : nous devrions plutôt nous situer à 5 %. D’où cette fourchette de 5 à 10 %. Et si l’on veut ramener cela au marché global du food retail, cela veut dire entre 2 et 4 %.
La plupart des acteurs étant partis de zéro, il est beaucoup plus simple de faire de la croissance. Des taux de progression à trois chiffres sont souvent affichés. On peut en effet dresser un parallèle entre l’essor du quick commerce et celui du drive dans les années 2000, puis du meal kit.
En revanche, la comparaison est plus difficile avec le drive piéton qui plafonne à 30/40 millions d’euros de chiffre d’affaires en France. Le drive piéton se développe peu, car le service n’est pas encore au niveau, globalement, de la promesse initiale qui consiste à offrir le choix et le prix de l’hyper en ville. Par exemple, Carrefour ne livre pas le jour-même : le client est obligé d’anticiper ses achats au moins la veille. Même si les chiffres montrent qu’énormément de drive piétons sont ouverts en France, la majorité d’entre eux consistent en des comptoirs de retrait à l’accueil des magasins. Si beaucoup de Parisiens ne savent pas encore ce qu’est le drive piéton, des enseignes comme Flink, Gorillas ou Cajoo bénéficient quant à elles d’une grande publicité.
À l’heure actuelle, nous avons peu de chiffres issus des groupes du quick commerce, même s’ils communiquent sur leur nombre de dark stores. Néanmoins, ce marché en France est déjà plus important que celui du drive piéton. En estimant que le quick commerce pourra capter, au global, une part de marché entre 2 et 4 %, cela représente à terme un montant potentiel de 2,5 milliards d’euros en France. Il est cependant difficile d’établir à quel horizon de temps cette taille sera atteinte, puisqu’une grande barrière demeure : la plupart de ces groupes sont encore enfermés dans une image de vendeurs pour des produits d’appoint (apéritif, papier toilette, contraceptifs, etc.).
Il est clair que, pour atteindre ce montant de 2,5 milliards d’euros, les groupes du quick commerce devront être en mesure de se créer une réelle image de marque. Et cela implique de vendre des produits frais, ce qui est plus difficile car le taux de perte est très élevé au démarrage. Il faut, en outre, inspirer suffisamment confiance au client. Entrent en ligne de compte les dates de péremption, la qualité des fruits et légumes reçus, la capacité à ne pas casser les œufs lors de la livraison, etc. Cela peut freiner le développement du online dans l’alimentaire.
Les groupes du quick commerce sont gourmands en capitaux, dans le but d’atteindre une taille critique. Comment peuvent-ils devenir rentables sur le long cours ?
Clément Genelot : Vous avez raison, ils sont aujourd’hui en perte. Leur marge d’EBITDA oscille entre -30 et -50 %. Cela me fait-il peur ? Non. Déjà, à l’époque, le meal kit était dans une situation similaire. De même, des groupes comme Deliveroo et Uber Eats sont passés par là lorsqu’ils sont apparus. Cela suit donc une trajectoire déjà observée par le passé. Et je fais le parallèle avec Uber Eats, parce que les groupes du quick commerce auront à peu près la même structure de coûts.
Il y aura trois variables pour devenir rentable. La première porte sur les frais marketing et les avoirs pour éduquer le client. Cela requiert, à ce stade, d’importants investissements. Il faut en effet faire connaître le service aux consommateurs et lui inspirer confiance. Ceci implique d’être assez agressif sur les avoirs et les promotions. Sans compter les frais de campagne sur Internet, de publicité à la télévision, d’affichage dans les stations de métro, etc. Une fois que le client sera davantage sensibilisé, il y aura moins de dépenses à mettre sur la table.
Le deuxième levier concerne les coûts d’achat et leur impact sur la marge brute. Les groupes du quick commerce sont assez jeunes, peu structurés. Ils achètent leurs produits auprès de grossistes, voire directement auprès des centrales d’achats de food retailers. En clair, leurs conditions d’achats ne sont pas optimales. Pour être en mesure d’interagir en direct avec les grandes marques nationales, il leur faut être plus gros en taille. Il leur faut aussi être capables de se faire livrer au niveau d’un hub régional ou national : les marques n’accepteront pas d’approvisionner quotidiennement un réseau de cinquante dark stores. Or, seuls des groupes comme Gorillas ou Getir disposent aujourd’hui de tels entrepôts. Les acteurs plus petits n’en ont pas. C’est aussi ce qui les empêche de négocier en direct avec les marques. Rien qu’avec les coûts d’achat, il y a de quoi améliorer la marge de l’ordre de dix points.
Le troisième aspect est également lié à la taille : il s’agit des coûts de livraison. D’autant plus en Europe, où le standard veut que les livreurs soient employés et non en freelance. Quand vos livreurs sont salariés, le but du jeu est de les occuper avec un maximum de livraisons par heure. Les opérateurs de dark stores parviennent, aujourd’hui, à faire accomplir par leurs employés deux livraisons par heure environ. L’objectif serait de passer de deux à trois, pour pouvoir abaisser le coût de livraison par commande. Mais cela suppose d’avoir une taille critique par zone et de développer des algorithmes, en interne, pour allouer les commandes de façon la plus optimale possible. Deliveroo, Uber Eats et autres détiennent de tels outils. Au contraire, la répartition des commandes se fait encore « à l’ancienne » pour la grande majorité des opérateurs de dark stores.
Sommes-nous aujourd’hui dans une phase de consolidation et de fusion des groupes du quick commerce, ou d’éclatement au travers d’une multitude de nouveaux acteurs ?
Clément Genelot : Nous sommes à mi-chemin entre les deux. On voit encore émerger de nouveaux acteurs, notamment dans les zones où ils demeurent peu nombreux. C’est le cas en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Même chose en Suisse, en Suède ou en Belgique. D’importants acteurs s’y mettent, comme le russe Yandex qui vient de lancer son business de dark stores en France et qui vise également l’Angleterre.
Mais les opérateurs déjà installés depuis au moins un an entrent dans une phase de consolidation. Dans les deux ou trois prochaines années, nous y serons toujours. Des acteurs vont fusionner entre eux. Cette vague de M&A aura lieu à la fois entre opérateurs de dark stores et avec d’autres acteurs. Les plateformes de livraison de repas (Deliveroo, Just Eat, DoorDash, Uber Eats, etc.) ont en tête d’investir le champ des dark stores en rachetant des entités spécialisées. C’est, pour eux, la suite logique. Dans une moindre mesure, les acteurs du food retail s’impliqueront aussi. Le fait que Carrefour prenne une participation minoritaire au capital de Cajoo n’est pas anodin.
À terme, je pense qu’il y a de la place pour trois ou quatre acteurs maximum par pays. Un ou deux domineront, de type Getir ou Gorillas, rejoints par un ou deux acteurs plus locaux, régionaux, se différenciant par la qualité de leur business model ou de leur offre. En France, Frichti est très en avance sur la partie relative aux produits frais, ce qui est un vrai élément de différenciation. Et ils proposent des plats déjà préparés.
Le quick commerce va-t-il nous amener à avoir encore plus recours au digital dans nos pratiques d’achat ?
Clément Genelot : Je pense que oui, dans le sens où le quick commerce est voué à digitaliser un segment du food historiquement en retrait d’un point de vue numérique. Le digital, en Europe et particulièrement en France, passait par le drive. Ceci est adapté pour un milieu rural et pour des courses de plein. Qu’un nouveau business model émerge et digitalise les courses de dépannage en milieu urbain apporte, il est vrai, un levier supplémentaire pour accentuer la présence du numérique dans le marché du food.
Et quand le consommateur aura pris goût à se faire livrer en dépannage et en moins de quinze minutes, il étendra cette exigence à d’autres segments de la consommation. C’est en train de prendre corps : Uber Eats, en France, livre en moins de trente minutes des bouquets de fleurs. Dans d’autres pays, des opérateurs de dark stores acheminent même des produits pharmaceutiques. Et pourquoi pas livrer à l’avenir, en moins de trente minutes, une boîte de chaussures ou un vêtement ? Le client va vite prendre goût à ces livraisons express depuis les magasins situés dans sa ville.
À l’époque, Amazon avait révolutionné la livraison online en mettant en place, aux États-Unis puis en Europe, la livraison en deux jours. Les consommateurs ont tellement apprécié qu’ils ont fini par l’exiger pour les autres sites. Vous avez toujours, dans le online, l’émergence de business qui imposent petit à petit de nouveaux standards. Le client est très prompt à transposer ces nouveaux standards à d’autres familles de produits. C’est en cela que les plateformes de livraison ont des potentiels de croissance monstrueux. Ils répondent à la question qui obsède les analystes depuis plusieurs années : comment assurer la livraison du dernier kilomètre ?